Inondations
Une menace planétaire
© 2022 Georama TV Films Productions / ARTE France /NHK
Une Co-Production



Avec la participation de



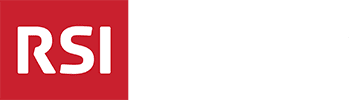



Avec le soutien de
La Région Midi Pyrénées
Procirep – ANGOA
Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel de
La Fédération Wallonie
Tax Shelter du Gouvernement Fédéral Belge




Inondations : une menace planétaire est une investigation documentée qui, de Shanghai à Tokyo, en passant par New-York et les Pays–Bas nous informe des risques et nous plonge dans la « résilience urbaine », un nouvel état d’esprit qui peut changer notre perspective sur l’avenir.
Les grandes mégapoles côtières de la terre sont de plus en plus menacées par les inondations. La mer monte et surtout les grandes villes construites sur les deltas s’affaissent. Elles perdent de 1 à 3 mètres en moyenne.
De nombreuses villes, comme New York, sont mal protégées. D’autres -comme Bangkok- sont sans solution face à cette menace.
Les eaux montent
Ces deux phénomènes, affaissement des villes et hausse des océans n’ont rien à voir l’un avec l’autre, mais ils aggravent la situation des inondations dans les grandes villes côtières. Certains scientifiques suggèrent qu’il faudra peut-être un jour abandonner des villes. Il faut donc protéger les mégapoles des assauts de la mer, et en particulier des ondes de tempête (ces vagues qu’on appelait autrefois « raz-de-marée).
Auteurs
Scénario
Nicolas Koutsikas, Emeraude Zervoudis et Marie Mandy
Équipe du film
Réalisation :
Marie Mandy
Scénario
Nicolas Koutsikas, Emeraude Zervoudis et Marie Mandy
Narration :
Marianne Cramer et Marie MAndy
Image :
Vincent Fooy
Son :
Patrick Maurois
Montage :
Yann Coquart, Colette Beltran, Françoise Ricard
Musique :
Hélène Blazy
Mixage :
Matthieu Cochin
Production :
Nicolas Koutsikas (Georama TV)
Scientifiques
MALCOLM BOWMAN, océanographe, Université de Stonybrook, NY
« Chaque année, il y a une chance sur cent qu’un ouragan comme Sandy se reproduise. Cela ne semble pas beaucoup, mais si j’étais assis dans un avion en attendant le décollage et que le pilote annonce : «Il y a une chance sur cent que cet avion tombe aujourd’hui ! », moi, je quitterais l’avion. Donc, le risque est en effet assez élevé.
ROBERT NICHOLLS, ingénieur côtier, Southampton
« De plus en plus de personnes se déplacent vers les villes. Plus de la moitié de la population vit dans les villes, nous ne sommes plus ruraux, nous sommes devenus une espèce urbaine ».
JAMES SYVITSKI, océanographe, Université du Colorado-Boulder, USA
« Qui sont ces gouvernements qui décident que c’est OK d’avoir 5 millions, 10 ou 20 millions de personnes qui vivent sur un delta sans les protéger efficacement ? »
STEFAN RAHMSTORF, climatologue, université de Potsdam
« Nous allons probablement perdre des villes côtières en raison de la montée de la mer parce que nous ne pourrons pas les protéger ».
STEPHANE HALLEGATTE, économiste, Banque Mondiale , Washington
« Il ne faut pas attendre une catastrophe pour agir, ce qu’il faut faire c’est exactement le contraire : agir avant la catastrophe »
SCOTT MC PARTLAND, chasseur de tempête, New York
“Jamais de ma vie je n’aurais cru que je filmerais un ouragan de la force de Sandy, ici dans ma ville natale de NYC.
ASHVIN DAYAL, bureau « 100 Villes résilientes », Bangkok
« Regardez par la fenêtre à Bangkokn les constructions en cours et posez-vous la question : est-ce que ces constructions ont été réalisées avec des modèles hydrologiques tenant compte des inondations, pour vérifier si en érigeant un bâtiment ici, la communauté qui va l’habiter va souffrir la prochaine fois qu’il y aura des pluies torrentielles ? Non. Les gens ne sont pas suffisamment éduqués, il n’y pas assez de sensibilisation à la manière dont ces schémas de pluie changent, comment ce risque d’un pour cent d’inondation passe à 2%, puis 10% puis 20% avec le changement climatique ».
TIANLIAN YANG, directeur du centre de contrôle de l’affaissement des sols, Shanghai
« La subsidence est un risque très important menaçant les gratte-ciels de Shanghai ».
MALCOLM BOWMAN, océanographe, Univ. de Stonybrook, NY
« Si on avait un testament cacheté, ou une capsule temporelle fermée pour 50 ans, et que les prochaines générations l’ouvraient, ils liraient : “Ecoutez, on a eu une immense catastrophe, et on a échoué à la prendre au sérieux, et on n’a pas fait assez pour protéger les générations futures”. Hé bien, ils se demanderaient vraiment pourquoi nous avons été si lents….
MICHAEL BERKOWICZ, Fondation Rockefeller New York
« La résilience urbaine est la capacité d’une ville à non seulement rebondir, mais aussi à continuer de se développer et prospérer, qu’elle soit confrontée à des épisodes aigus, qu’on appelle chocs, ou des problèmes chroniques qu’on appelle stress. C’est valable pour le climat comme pour le terrorisme ».
HENK OVINK, envoyé special pour les affaires de l’eau, Pays-Bas
« Pour aller de l’avant, que faut-il faire? Ne pas utiliser Sandy, ou Irène ou Katrina comme référence pour ce que l’on va faire. Il faut utiliser le futur comme référence, ce qui veut dire, par définition, que nous allons devoir innover »
KATE ORFF, architecte, New York
« Moi, ce que je ne veux plus voir, ce sont des murs dans le paysage. Je ne veux plus voir les gens coupés de la nature. Cela fait 200 ans que l’on fait ça ».
DAWN ZIMMER, maire de la ville de Hoboken, New Jersey
« Il y a la résilience, mais il y a aussi la capacité à prendre des décisions difficiles “Non, vous ne pouvez pas construire sur nos jetées. Vous ne pouvez pas construire sur le front de mer”. On ne va pas mettre nos futurs résidents en danger en acceptant des constructions sur notre littoral ».
KATE ORFF, architecte, New York
« Nous avons besoin d’une idéologie différente, d’un engagement nouveau avec le monde naturel. Qui ne repose pas sur le contrôle, qui ne consiste pas à “bloquer” mais qui augmente notre perception et augmente notre engagement actif »

Organiser une projection ou une conférence









